
Vous en avez peut-être fait l’expérience, le télétravail ne se résume pas à mettre les gens à distance avec un ordinateur et une connexion wifi (qui n’en restent pas moins nécessaires). Fidèle à l’adage « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement », voici quelques rappels de base pour organiser chez soi un télétravail efficace, travailler en équipe distante ou encore manager des télétravailleurs.
Aménager son espace de travail
Travailler à distance, ce n’est pas travailler de n’importe où chez soi. Il faut se mettre dans des conditions favorables, idéalement un endroit calme et dédié : un bureau à part entière, un bureau dans votre chambre, une chaise et une table dans votre salon, etc. Pensez aux bonnes pratiques ergonomiques (acquises au bureau) concernant l’aménagement physique de votre poste de travail (postures de travail, positionnement des écrans, etc.) afin d’éviter l’apparition de troubles musculosquelettiques.
Se fixer des horaires de travail
En télétravail, on ne travaille pas moins, on ne travaille pas plus. On commence à l’heure, on fait ses pauses aux mêmes heures, on termine à la même heure. L’idéal est donc de conserver la même amplitude qu’en présentiel, ne pas sacrifier les pauses et encore moins la pause déjeuner. En somme, veillez à conserver de bonnes pratiques de déconnexion afin de préserver les temps de repos et de concilier au mieux la vie personnelle et la vie professionnelle.
S’organiser avec sa famille
Télétravailler seul chez soi est une chose. Télétravailler lorsqu’il y a du monde en est une autre. Il peut être utile d’élaborer des règles, surtout si le conjoint télétravaille également et/ou si les enfants sont là. Il s’agit bien sûr de règles de bon sens telles que : pas d’accès intempestifs à la pièce de télétravail, respect de la tranquillité de chacun, temps de repas et de pause définis pour tous, etc.
A cadre différent, activités différentes : définir la « feuille de route » du télétravailleur
Analysez les tâches qui sont faisables à distance et le temps qu’elles prendront, hiérarchisez les priorités. Inventez, si besoin, de nouvelles missions : profitez de cette période pour travailler des dossiers de fonds, faire des analyses, du benchmark ou anticipez les projets à relancer quand l’activité aura repris complètement.
Créer des rituels, des temps de communication dédiés
Créez des rituels, qui permettent de rythmer la journée/ la semaine de travail en maintenant le lien avec votre équipe. Cela peut être un point matinal à une heure fixe, ou plusieurs contacts dans la semaine. Favorisez les appels téléphoniques, si possible en mode visioconférence, pour humaniser la communication et éviter certains malentendus qui pourraient intervenir par écrit. On peut aussi sur un mode plus « ludique » organiser des pauses "machine à café" virtuelles, s’envoyer des photos de nos bureaux virtuels, etc.
S'interroger sur ce qui fonctionne ou pas
Quels enseignements tirer des premiers temps ? Qu’est-ce qui fonctionne bien, qu’est-ce qui est à améliorer ou changer ? Les audioconférences sont-elles efficaces, avec des ordres du jour, des relevés de décisions ? Que penser de l’utilisation des dispositifs de visioconférence ? Sortez du cadre, testez de nouvelles pratiques.
Laisser de la place pour l'expression émotionnelle individuelle
Entendez les difficultés, laissez de l'espace pour s'écouter les uns les autres, bref ne parlez pas que « reporting et activités ».
Prendre soin de vous
Collaborateur comme manager, tous sont des maillons essentiels de la chaine organisationnelle. Pour durer, il faut que vous fassiez attention à vous : soyez prudents et ménagez vos forces.
Bon télétravail à tous !
Aménager son espace de travail
Travailler à distance, ce n’est pas travailler de n’importe où chez soi. Il faut se mettre dans des conditions favorables, idéalement un endroit calme et dédié : un bureau à part entière, un bureau dans votre chambre, une chaise et une table dans votre salon, etc. Pensez aux bonnes pratiques ergonomiques (acquises au bureau) concernant l’aménagement physique de votre poste de travail (postures de travail, positionnement des écrans, etc.) afin d’éviter l’apparition de troubles musculosquelettiques.
Se fixer des horaires de travail
En télétravail, on ne travaille pas moins, on ne travaille pas plus. On commence à l’heure, on fait ses pauses aux mêmes heures, on termine à la même heure. L’idéal est donc de conserver la même amplitude qu’en présentiel, ne pas sacrifier les pauses et encore moins la pause déjeuner. En somme, veillez à conserver de bonnes pratiques de déconnexion afin de préserver les temps de repos et de concilier au mieux la vie personnelle et la vie professionnelle.
S’organiser avec sa famille
Télétravailler seul chez soi est une chose. Télétravailler lorsqu’il y a du monde en est une autre. Il peut être utile d’élaborer des règles, surtout si le conjoint télétravaille également et/ou si les enfants sont là. Il s’agit bien sûr de règles de bon sens telles que : pas d’accès intempestifs à la pièce de télétravail, respect de la tranquillité de chacun, temps de repas et de pause définis pour tous, etc.
A cadre différent, activités différentes : définir la « feuille de route » du télétravailleur
Analysez les tâches qui sont faisables à distance et le temps qu’elles prendront, hiérarchisez les priorités. Inventez, si besoin, de nouvelles missions : profitez de cette période pour travailler des dossiers de fonds, faire des analyses, du benchmark ou anticipez les projets à relancer quand l’activité aura repris complètement.
Créer des rituels, des temps de communication dédiés
Créez des rituels, qui permettent de rythmer la journée/ la semaine de travail en maintenant le lien avec votre équipe. Cela peut être un point matinal à une heure fixe, ou plusieurs contacts dans la semaine. Favorisez les appels téléphoniques, si possible en mode visioconférence, pour humaniser la communication et éviter certains malentendus qui pourraient intervenir par écrit. On peut aussi sur un mode plus « ludique » organiser des pauses "machine à café" virtuelles, s’envoyer des photos de nos bureaux virtuels, etc.
S'interroger sur ce qui fonctionne ou pas
Quels enseignements tirer des premiers temps ? Qu’est-ce qui fonctionne bien, qu’est-ce qui est à améliorer ou changer ? Les audioconférences sont-elles efficaces, avec des ordres du jour, des relevés de décisions ? Que penser de l’utilisation des dispositifs de visioconférence ? Sortez du cadre, testez de nouvelles pratiques.
Laisser de la place pour l'expression émotionnelle individuelle
Entendez les difficultés, laissez de l'espace pour s'écouter les uns les autres, bref ne parlez pas que « reporting et activités ».
Prendre soin de vous
Collaborateur comme manager, tous sont des maillons essentiels de la chaine organisationnelle. Pour durer, il faut que vous fassiez attention à vous : soyez prudents et ménagez vos forces.
Bon télétravail à tous !
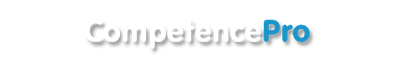
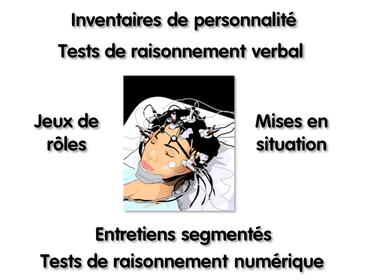
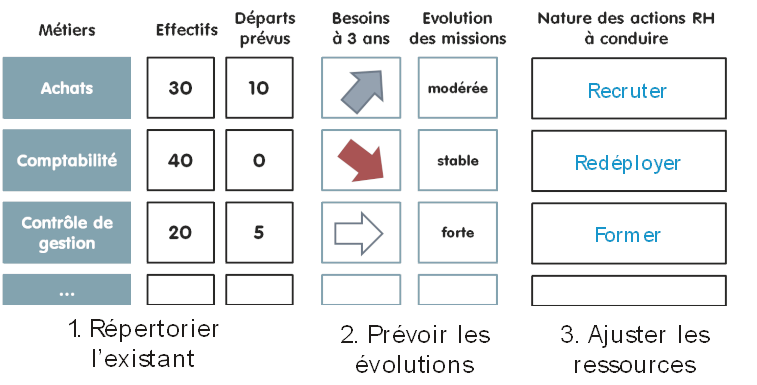
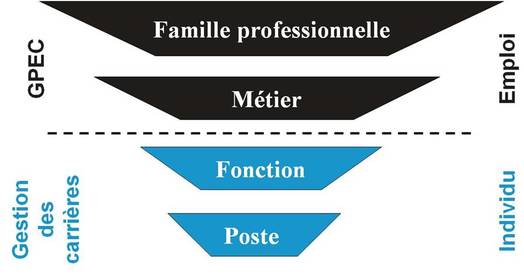
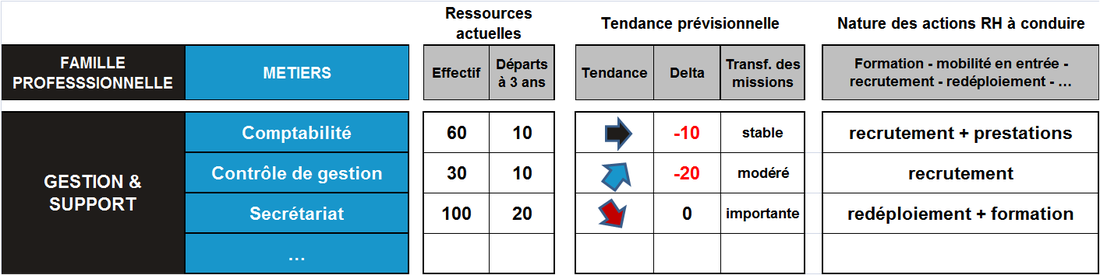
 Flux RSS
Flux RSS